RÃĐseaux Humains / RÃĐseaux Technologiques, journÃĐes d'ÃĐtude de l'UniversitÃĐ de Poitiers
Des usages attendus aux usages effectifs dans lâENT de lâUNR-Languedoc Roussillon
TroisiÃĻme partie - Des analyses d'usages
Par Chantal Charnet
PubliÃĐ en ligne le 1 septembre 2006
RÃĐsumÃĐ : Cette ÃĐtude vise à ÃĐvaluer les ÃĐcarts entre les pratiques attendues par les concepteurs du projet, les dÃĐcideurs universitaires et leur appropriation effective par les ÃĐtudiants, par le biais dâune mÃĐthodologie de la confrontation. Elle a ÃĐgalement recours à lâanalyse conversationnelle, sur la base  dâextraits dâÃĐchanges entre acteurs engagÃĐs dans la mise en place de lâENT. En effet, lâexplicitation des usages potentiels constitue un socle rÃĐfÃĐrentiel oÃđ attentes et intentions pourront Être confrontÃĐes aux usages effectifs. Les activitÃĐs humaines supportÃĐes par les artefacts prÃīnÃĐes dans cette phase dâexplicitation sont dÃĐgagÃĐes, ceci sâinscrivant dans une rÃĐflexion sur les relations de lâobjet à lâaction, en particulier celle avec des objets informationnels, en rÃĐfÃĐrence à la thÃĐorie de lâAction SituÃĐe (J. Lave, L. Suchman). Lâanalyse des phÃĐnomÃĻnes verbaux et gestuels ÃĐmis sur ces pratiques par les acteurs engagÃĐs dans le projet fait rÃĐfÃĐrence à la problÃĐmatique des âcadres de lâexpÃĐrienceâ? proposÃĐe par E. Goffman (1974/1991).
Sommaire
Dans le cadre de la mise en Åuvre des environnements numÃĐriques du projet UniversitÃĐ NumÃĐrique en rÃĐgion Languedoc Roussillon (2004-2005), une prÃĐ-enquÊte sur les usages ÃĐducatifs des environnements numÃĐriques de travail (ENT) est en cours. Plus spÃĐcifiquement, le projet ENTICE1 retenu dans le cadre du 2ÃĻme appel à projet ÂŦ Usages de lâInternet Âŧ2 constituera la toile de fond de notre rÃĐflexion. Il a pour objectif de rendre compte des usages ÃĐducatifs dans les pratiques ÃĐmergentes dâun espace numÃĐrique de travail (ENT) pour les UniversitÃĐs de Montpellier 1, 2, 3 et Perpignan. Nous abordons dâabord une rÃĐflexion sur les orientations mÃĐthodologiques, puis nous prÃĐsenterons deux sÃĐquences vidÃĐo qui illustreront quelques phÃĐnomÃĻnes en cours dâexploration.
Comment repÃĐrer et analyser des usages liÃĐs à la mise en place de dispositifs technologiques dans lâEnseignement SupÃĐrieur ? Telle est notre interrogation dans le cadre du projet ENTICE. LâENT3 ÂŦ dÃĐsigne un dispositif global fournissant à un usager un point dâaccÃĻs à travers les rÃĐseaux à lâensemble des ressources et des services numÃĐriques en rapport avec son activitÃĐ. Il est un point dâentrÃĐe pour accÃĐder au systÃĻme dâinformation de lâÃĐtablissement ou de lâÃĐcole. Âŧ (2004 : 4). Celui-ci ÂŦ sâadresse à lâensemble des usagers, ÃĐlÃĻves, parents dâÃĐlÃĻves, ÃĐtudiants, enseignants, personnels administratifs, techniques et dâencadrement des ÃĐtablissements dâenseignement. Âŧ (2004 : 4). Lâun des volets dâÃĐtude du projet ENTICE est lâobservation des usages ÃĐducatifs dâInternet dans le cadre de lâUNR- Languedoc Roussillon.
Mais prÃĐcisons dâabord ce que lâon entend par usage. Les usages sont des comportements individuels ou collectifs repÃĐrables car souvent systÃĐmatiques dans les diffÃĐrentes activitÃĐs des individus. Ils sont situÃĐs câest-à -dire effectivement engagÃĐs dans lâaccomplissement dâune activitÃĐ rÃĐelle et placÃĐe dans sa temporalitÃĐ (Heath et Luff, 2000). En outre, ils ne peuvent pas Être considÃĐrÃĐs comme apparaissant à lâimproviste au moment oÃđ un usager prend possession du dispositif, ou à une autre phase dâutilisation. En effet, les usages ont une antÃĐrioritÃĐ constitutive que nous prendrons en compte lors de lâobservation. En fait, ils sont issus dâune rÃĐflexion, dans notre cas pÃĐdagogique et technologique, qui prÃĐfigure des attendus dans les pratiques. Les besoins des ÃĐtudiants et des enseignants, tels quâils sont perçus par les dÃĐcideurs, interviennent dans le choix de lâespace numÃĐrique ; celui-ci doit Être à mÊme de rÃĐpondre aux objectifs dâusages posÃĐs comme indispensables. La contrainte technologique ne doit pas Être minimisÃĐe car elle oriente, de par ses potentialitÃĐs, la fonctionnalitÃĐ de lâoutil qui participe, matÃĐriellement et par le biais dâartefacts cognitifs, aux activitÃĐs des usagers. Des contraintes affÃĐrentes à lâordre politique doivent Être reconnues car les dÃĐcideurs ont un pouvoir essentiel dans la mise en Åuvre du dispositif.
Une politique universitaire non engagÃĐe dans le processus technologique ne favorisera pas une pratique effective rapide et ne pourra donc pas soutenir des actions communicatives dans ce sens. Enfin, un autre ÃĐlÃĐment doit Être pris en considÃĐration, câest lâinnovation dans un contexte ÃĐducatif non encore rÃīdÃĐ Ã des activitÃĐs utilisant les nouvelles technologies. En fait, les pratiques ÃĐmergentes, les cadres primaires4  ne sont pas encore vÃĐritablement ancrÃĐs, ni chez les participants au projet ni auprÃĻs des personnes impliquÃĐes dans le projet. Lâinnovation prÃĐsente aussi une particularitÃĐ : elle influence le discernement que nous avons de telle ou telle activitÃĐ, et ce, tout au long de la mise en place des dispositifs. Comme le note Elizabeth BRODIN (2002 :152), ÂŦ La sociologie des innovations [Latour93]5 nous rappelle que le processus dâinnovation se dÃĐveloppe dans un environnement qui se modifie en mÊme temps que le projet et avec lui, selon un phÃĐnomÃĻne de recomposition mutuelle. Ce nâest pas la qualitÃĐ de lâidÃĐe originelle qui fait celle de lâinnovation, mais ce qui se passe pendant le processus (facilement contrariÃĐ, perturbÃĐ par des alÃĐas divers) et fait que les bonnes idÃĐes arrivent plutÃīt vers la fin [LhommeFleury99]6.Âŧ. Ainsi, si les usagers sâorientent volontairement dans lâinnovation ou mÊme sâils sây voient forcÃĐs, des modifications de comportement apparaissent dans les usages attendus au cours de lâinstallation et durant le dÃĐroulement des activitÃĐs. Les pratiques innovantes se modifient au fur et à mesure du dÃĐveloppement du dispositif.
Mais la question se pose de comment observer, comment dÃĐcrire, voire comprendre les usages en question. Nous choisirons de nous placer dans une perspective dâanalyse conversationnelle oÃđ lâanalyse des productions verbales (et non-verbales) permet dâaccÃĐder aux connaissances et aux croyances des acteurs sociaux. De plus, la notion de script nous offrira la possibilitÃĐ de rÃĐflÃĐchir au cadre dans lequel sâaccomplissent les activitÃĐs observÃĐes et de prendre en considÃĐration les conduites attendues. Enfin, nous ferons rÃĐfÃĐrence à la notion de cadre telle quâelle est prÃĐsentÃĐe par E Goffman (1974/1991 : 19)) : ÂŦ Je soutiens que toute dÃĐfinition de situation est construite selon des principes dâorganisation qui structurent les ÃĐvÃĐnements â du moins ceux qui ont un caractÃĻre social â et notre propre engagement subjectif. Le terme de ÂŦ cadre Âŧ dÃĐsigne ces ÃĐlÃĐments de base. Lâexpression ÂŦ analyse de cadres Âŧ est, de ce point de vue, un mot dâordre pour lâÃĐtude de lâorganisation de lâexpÃĐrience. Âŧ. Afin dâanalyser lâexpÃĐrience que font les usagers des ENT, nous nous intÃĐresserons aux diffÃĐrentes phases de mise en place et du dÃĐroulement du dispositif. LâÃĐtude des ÂŦ cadres primaires Âŧ, ÂŦ qui nous permettent de localiser, de percevoir, dâidentifier et de classer un nombre infini dâoccurrences entrant dans leur champ dâapplication Âŧ (30) propose une orientation mÃĐthodologique pertinente pour notre recherche.
Nous devons enfin nous interroger sur les angles dâanalyse. Comment celle-ci doit-elle sâorienter ? Quelle est la focale à choisir ? Et pour sâaccorder avec la mÃĐthodologie dâE. Goffman (1974/1991), nous dirons que cette description peut se faire ÂŦ en gros plan ou à distance Âŧ (16) sachant quâun problÃĻme identique se pose quant à la perspective. En effet, pour une mÊme situation, diffÃĐrents points de vue sâexpriment. Aussi, pour pallier toutes ces atteintes de la rÃĐalitÃĐ, nous appuierons-nous, dans la mesure du possible, non pas sur des sÃĐquences ÂŦ rÃĐtrospectives Âŧ (18) mais sur des activitÃĐs en cours.
Une mÃĐthodologie de la confrontation sera pratiquÃĐe ; elle consiste à comparer les usages attendus et effectifs. Pour construire celle-ci, une analyse se dÃĐroulera sur deux plans ÂŦ à distance Âŧ et en ÂŦ gros plan Âŧ, les usages attendus et effectifs seront croisÃĐs pour confirmer ou infirmer les observations effectuÃĐes. Nous alimenterons une ÃĐtude comparative entre les diffÃĐrentes phases dâinstallation et dâexploitation du projet puisque nous viserons une ÃĐtude sur les relations entre conception et utilisation7 pour analyser plus particuliÃĻrement les usages ÃĐducatifs. Dans la mise en place dâun ENT, le choix du dispositif technologique constitue une phase importante puisque des comportements ont ÃĐtÃĐ prÃĐvus par les concepteurs dans son fonctionnement technique et dans ses possibilitÃĐs technologiques. De plus, les dÃĐcideurs (responsables pÃĐdagogiques et administratifs) ont des attentes en relation à leurs pratiques et à celles des autres catÃĐgories. Ces anticipations sont en relation avec les possibilitÃĐs technologiques du dispositif proposÃĐ.
Les dÃĐcideurs attendent en effet un autre dÃĐroulement des procÃĐdures nÃĐcessaires dans lâaccomplissement de la vie universitaire. Cela concerne essentiellement les domaines de lâinformation, de lâinscription, de la gestion des ressources, de la transmission du savoir, etc. Afin de transmettre au personnel enseignant et administratif et aux ÃĐtudiants, les attentes prÃĐvues, des  opÃĐrations de communication et dâinformation sont nÃĐcessaires. Enfin, les usagers (ÃĐtudiants, enseignants, administratifs) vont prendre le dispositif en main et sâen servir dans le quotidien. Des problÃĻmes dâÃĐquipement se posent ÃĐgalement pour accÃĐder au dispositif. En fait, à lâinitiation des usages attendus, deux points de vue convergent pour motiver leur dÃĐroulement, celui du concepteur qui façonne un produit pour initier des pratiques rÃĐpondant au cahier des charges à la base de la rÃĐalisation du produit, et celui du dÃĐcideur qui choisit le produit et oriente par des actions coordonnÃĐes lâutilisation du dispositif lâincluant dans une dÃĐmarche plus globale. Le projet ENTICE a ainsi pour objectif de comparer les usages ÃĐducatifs initiÃĐs par les concepteurs, prescrits par les dÃĐcideurs universitaires et effectivement rÃĐalisÃĐs par les ÃĐtudiants, enseignants et administratifs.
Dans lâanalyse spÃĐcifique à ce projet, les donnÃĐes seront constituÃĐes par des productions rÃĐalisÃĐes in situ et seront des sÃĐquences vidÃĐo enregistrÃĐes mais aussi des productions antÃĐrieures ou postÃĐrieures aux activitÃĐs enregistrÃĐes. Les enregistrements et la rÃĐcolte des donnÃĐes doivent sâeffectuer dÃĻs le dÃĐbut des opÃĐrations. Par exemple, notre intÃĐrÊt porte aussi bien sur la sÃĐquence elle-mÊme que sur lâordre du jour et le compte rendu qui peuvent Être produits. Ces donnÃĐes apporteront ainsi certaines perspectives dâun mÊme ÃĐvÃĐnement. Une approche situationnelle à vision multiple sera ainsi accessible à lâanalyste.
LâÃĐtude ÂŦ à distance Âŧ observera le dÃĐploiement des ENT dans la rÃĐgion Languedoc Roussillon, selon le calendrier de mise en Åuvre ÃĐtabli par lâUNR. Il consiste à prendre en compte les quatre orientations de mise en Åuvre :
-
Participation à lâÃĐtude des besoins, au niveau global et  au niveau de la mise en place des infrastructures et des services,
-
Suivi de la mise en Åuvre du dispositif sur site test (UniversitÃĐ de Perpignan et UniversitÃĐs de Montpellier)
-
Evaluation du dÃĐploiement du dispositif sur lâensemble des sites et des conditions de mise en service en grandeur rÃĐelle.
-
Observation et analyse de lâutilisation des TIC par les usagers.
Ces observations à distance du dÃĐploiement de la mise en place du dispositif se croiseront avec celles en gros plans.
Une analyse en ÂŦ gros plans Âŧ sâappuie sur des enregistrements dâactivitÃĐs se situant dans chacune des phases de mise en place et dâexpÃĐrimentation de lâENT. Dans la premiÃĻre phase, il sâagit essentiellement de pÃĐriodes de rÃĐunions, desquelles ont ÃĐtÃĐ extraites des sÃĐquences qui ont ÃĐtÃĐ jugÃĐes signifiantes pour comprendre la mise en place de pratiques routinisÃĐes.
Pour illustrer ces observations, nous analyserons deux sÃĐquences, tirÃĐes de deux rÃĐunions dâinformation qui se situent dans une phase prÃĐparatoire dâinformation avant la mise en place de lâENT. La premiÃĻre, coordonnÃĐe par le chef de projet de lâUNR et la responsable de lâenseignement à distance dâun ÃĐtablissement universitaire, a pour cible les enseignants dâun mÊme ÃĐtablissement et se situe en mars 2004 ; la seconde, effectuÃĐe par une responsable technique, sâadresse essentiellement à un personnel administratif et technique issu de plusieurs ÃĐtablissements, et se dÃĐroule en juin 2004.
Notre propos est ainsi de comprendre ÂŦ lâorganisation de lâexpÃĐrience Âŧ (Goffman 1991) par lâanalyse de phÃĐnomÃĻnes extraits de ces sÃĐquences. Si des ÃĐvÃĐnements ou des faits viennent contrarier le dÃĐroulement de lâattendu, le segment perturbÃĐ demande une analyse et peut provoquer à plus long terme un changement du cadre. La recherche de ces indices saillants constitue lâune des bases de lâanalyse.
Lâanalyse de deux sÃĐquences nous dÃĐmontrera en quoi les connaissances partagÃĐes participent à la dÃĐfinition dâun cadre primaire commun. La comprÃĐhension de lâorganisation du dispositif lui-mÊme constitue un des points de rencontre entre les participants au projet. Chacune des sÃĐquences proposÃĐes montre deux ÃĐtats, un ÃĐchec et une rÃĐussite dans la mise en commun des perspectives. La premiÃĻre souligne lâabsence dâhorizon partagÃĐ qui interdit toute proposition dâusages. La seconde met en valeur le fait que des participants coopÃĻrent et quâune entente sâÃĐtablit pour ÃĐnoncer des usages attendus. Notons aussi que les cibles sont diffÃĐrentes, enseignante pour la premiÃĻre et administrative pour la seconde et quâelles se situent à des moments dÃĐcalÃĐs chronologiquement : la premiÃĻre sâest dÃĐroulÃĐe deux mois avant la deuxiÃĻme. Enfin, lâanalyse des sÃĐquences enregistrÃĐes donne la possibilitÃĐ dâaccÃĐder à ÂŦ ce quâun acteur individuel peut abriter dans son esprit Âŧ (Goffman 1991 : 22).
Les conventions de transcription sont dÃĐtaillÃĐes en fin dâarticle.
Participants : Responsables de la mise en place de lâUNR (R1 et R2), responsable  EAD (R3), enseignants dâun mÊme ÃĐtablissement (soit en groupe, E, soit individualisÃĐ E1, E2,  âĶ).
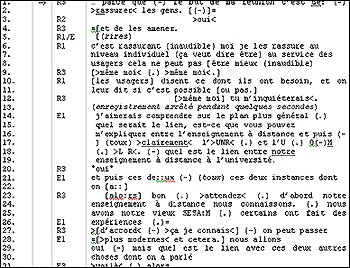
Le principal motif de la rÃĐunion concernÃĐe est une information ciblÃĐe sur la notion dâenvironnement et de dispositifs virtuels puisque ceux-ci doivent se mettre en place dans les mois qui suivent cette rencontre. Si les responsables de la mise en Åuvre connaissent les principes de fonctionnement, ce nâest pas le cas des utilisateurs futurs qui sont les enseignants. Trois catÃĐgories dâacteurs sont ainsi à diffÃĐrencier, les initiÃĐs (R1, R2) nâappartenant pas à lâÃĐtablissement mais totalement engagÃĐs dans la mise en Åuvre du projet, les informÃĐs (R3) ayant acquis des connaissances par des rencontres antÃĐrieures avec la premiÃĻre catÃĐgorie et les non-initiÃĐs (lâensemble E) qui nâont pas dâidÃĐes prÃĐcises sur les dispositifs prÃĐsentÃĐs ; la deuxiÃĻme et troisiÃĻme catÃĐgorie appartiennent au mÊme ÃĐtablissement. La rÃĐunion a en fait pour objectif de faire passer la troisiÃĻme catÃĐgorie au moins dans la deuxiÃĻme.
Lâabsence de connaissances partagÃĐes portant sur les environnements ÃĐducatifs virtuels provoque des prises de parole mettant en avant lâincomprÃĐhension des acteurs de la troisiÃĻme catÃĐgorie et parfois de la deuxiÃĻme. Si la prise de parole de la personne responsable de lâenseignement à distance (R3) marque lâobjet de la rÃĐunion ÂŦ rassurer Âŧ :
parce que (-) le but de ma rÃĐunion câest de: (-)
>rassurer< les gens. [(-)]= (1-2),
Elle expose aussi des inquiÃĐtudes qui sâaffirment dans lâintervention dâune enseignante (E1)Â :
jâaimerais comprendre sur le plan plus gÃĐnÃĐral (.) (14).
LâÃĐtude des ÃĐchanges entre les deux personnes met à jour lâabsence de perspectives communes. En effet, tout dâabord lâenseignante dans une modalisation interrogative montre son incomprÃĐhension à relier deux instances quâelle a du mal à reconnaÃŪtre.
Elle ÃĐpelle les termes qui dÃĐsignent lâorganisation et le dispositif :
puis (-) (toux) >clairement< Â lâ>UNR< (.) et lâU
(.) O(-)M (.) >L R<. (-) quel est le lien entre
notre enseignement à distance à lâuniversitÃĐ.(17-19),
alors que les personnes qui ÃĐtaient sur lâestrade les avaient ÃĐnoncÃĐs dans une fluiditÃĐ affirmÃĐe. Ainsi, elle oppose dâun cÃītÃĐ des ÃĐlÃĐments inconnus (UNR et UO-MLR) à celui dâun connu qui est dans sa sphÃĻre quotidienne (ÂŦ notre enseignement à distance Âŧ) et demande une explication qui lui permette dâapprÃĐhender, voire de sâapproprier les nouveaux ÃĐlÃĐments qui lui sont proposÃĐs ; dâailleurs la dÃĐsignation finale marquÃĐe par le terme de ÂŦ choses Âŧ confirme lâabsence dâun territoire commun de connaissances :
oui (-) mais quel est le lien avec ces deux autres
choses dont on a parlÃĐ (29-30).
Ces phÃĐnomÃĻnes de ratages et de choix lexicaux donnent accÃĻs à la construction, ou plutÃīt dans ce cas à lâabsence de reconnaissance de la thÃĐmatique avancÃĐe. Ils sont lâexpression dâun ÃĐchec dans la rÃĐception attendue de la prÃĐsentation. Ils concrÃĐtisent lâÃĐtat de gÊne dâune personne qui nâa pas accÃĻs au sens car toutes les informations ne lui ont pas ÃĐtÃĐ transmises. Celle-ci ne perçoit donc pas les dispositifs en question quâils soient sociaux ou technologiques dans le domaine qui la prÃĐoccupe, lâenseignement à distance. Un gros plan sur les ÃĐchanges entre les catÃĐgories discernÃĐes met en avant la difficultÃĐ dâintercomprÃĐhension entre les catÃĐgories ; les ÃĐchecs de dÃĐsignation confirment la difficultÃĐ de la troisiÃĻme catÃĐgorie à seulement passer à la deuxiÃĻme. En fait, cette absence de concrÃĐtisation empÊche toute ÃĐnonciation de besoins et encore moins de demandes. La discussion sur les usages ne peut sâeffectuer à ce stade car le dispositif social, pÃĐdagogique et technologique lui-mÊme nâest pas apprÃĐhendÃĐ.
Lieu : Etablissement universitaire
Participants : Responsables de la mise en place de lâUNR (R1 et R2) ; Responsable technique (R3).
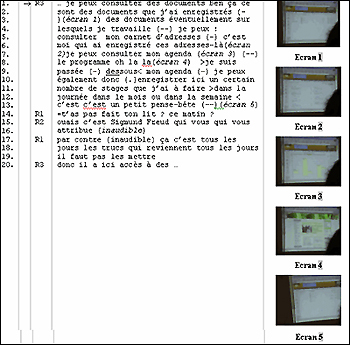
Lâobjectif de la deuxiÃĻme sÃĐquence est de prÃĐsenter à des participants au projet UNR le fonctionnement dâun ENT dans une autre rÃĐgion en France ; les acteurs de la deuxiÃĻme sÃĐquence qui prennent la parole appartiennent tous à la premiÃĻre catÃĐgorie, celle des initiÃĐs tandis que les autres participants qui nâinterviennent pas dans lâinteraction sont de la deuxiÃĻme ou troisiÃĻme catÃĐgorie. Les intervenants ont ainsi une connaissance partagÃĐe sur le dispositif dâun ENT. La prÃĐsentation effectuÃĐe par une responsable technique fait rÃĐfÃĐrence à lâÃĐtat existant dâun ENT dans une rÃĐgion donnÃĐe ; elle montre les possibilitÃĐs dâactions pour un ÃĐtudiant sous forme dâune ÃĐnumÃĐration verbale associÃĐe à une visualisation verbale accessible à lâensemble des personnes prÃĐsentes. La formulation des actions envisagÃĐes est donc associÃĐe à une navigation perceptible  par tous. Les activitÃĐs sont ainsi dÃĐcrites et visualisÃĐes. La description effectuÃĐe ÃĐlabore le contexte en faisant rÃĐfÃĐrence à des documents prÃĐsents sur lâÃĐcran par des ÃĐnoncÃĐs indexicalisÃĐs :
ce sont des documents que jâai enregistrÃĐs (S2Â : 1-2)
ces adresses-là (S2 : 6)
Lâusage attendu se voit stabilisÃĐ par la description de la pratique dÃĐcrite. Les expressions indexicales ordonnent lâorganisation et confortent la rÃĐalitÃĐ de lâusage explicitÃĐÂ : elles sont le tÃĐmoignage de lâusage envisagÃĐ (Garfinkel et Sacks, 1986).
Le deuxiÃĻme phÃĐnomÃĻne saillant que nous relÃĻverons montre ÃĐgalement que lâexpression indexicale construit une rÃĐalitÃĐ immÃĐdiate qui modifie le comportement verbal et induit une potentialitÃĐ dâusages. Dans cette sÃĐquence, lâexpression dâune plaisanterie change le comportement verbal de la prÃĐsentatrice, obligÃĐe de rÃĐagir à une intervention et à celle de lâenvironnement participatif. Dans une prÃĐsentation qui se voudrait formelle, lâintroduction dâun mot dâesprit ÃĐmise par lâun des responsables, introduit, dans la partie "agenda", une pratique que nous pourrions ÃĐnoncer de la maniÃĻre suivante : ÂŦ ne pas mettre des actions que lâon fait systÃĐmatiquement tous les jours Âŧ.
ça câest tous les jours les trucs qui reviennent tous les jours il faut pas les mettre (S2 : 17-19)
La  rÃĐfÃĐrence à ce qui vient dâÊtre dit suggÃĻre un  comportement qui est confirmÃĐ par la plaisanterie ÃĐnoncÃĐe.
Ces ÃĐvÃĐnements que lâon peut juger comme furtifs ou anodins constituent en fait des ÃĐlÃĐments constructeurs des usages. La premiÃĻre sÃĐquence montre la difficultÃĐ dâ ÂŦ imaginer Âŧ des usages quand le dispositif nâest pas rÃĐellement effectif et que les connaissances ne sont pas partagÃĐes entre tous les participants et la deuxiÃĻme montre que les ÃĐnoncÃĐs indexicaux permettent de faire rÃĐfÃĐrence à des actions en train de sâaccomplir, de les modifier par une visualisation effective de lâaction en cours : câest une premiÃĻre perception des usages.
Lâapproche prÃĐsentÃĐe montre que lâanalyse des interactions verbales constitue une premiÃĻre approche des usages mÊme si ces derniers ne sont pas encore effectifs. Lâattention portÃĐe à ce qui se dit et se fait donne la possibilitÃĐ dâinduire les usages attendus. Lâexplicitation des attentes et des intentions profile une premiÃĻre typologie de pratiques ÃĐmergentes qui constituera un premier cadre primaire lors de lâobservation des usages rÃĐels. En effet, sachant que le dÃĐterminisme technique nâest plus de mise, nous cernons dans un premier temps, les schÃĻmes dâusage attendus des technologies prÃĐsentes dans les ENT et verbalisÃĐs lors de prÃĐsentations publiques. Nous allons diffÃĐrencier ceux venant du comportement des individus et ceux prÃĐsents dans lâenvironnement technologique dans la logique dâune cognition situÃĐe et distribuÃĐe. Lâobservation attentive des comportements des diffÃĐrents acteurs tout au long de la mise en Åuvre et de la  place du projet dÃĐveloppÃĐ sâavÃĻre essentielle dans la constitution des pratiques routinisÃĐes. En cela, lâanalyse interactionnelle constitue un outil pertinent et adaptÃĐ Ã une recherche sur les usages.
Pour citer cet article :  Charnet Chantal (2005). "Des usages attendus aux usages effectifs dans lâENT de lâUNR-Languedoc Roussillon". Actes des 5 et 6ÃĻmes Rencontres RÃĐseaux Humains / RÃĐseaux Technologiques. Poitiers et La Rochelle, 16 et 17 mai 2003 â 25 et 26 juin 2004. "Documents, Actes et Rapports pour l'Education", CNDP, p. 123-132.
En ligne : http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt/document692.php
Notes
Bibliographie
CHARLIER Bernadette et PERAYA Daniel,Technologie et innovation en pÃĐdagogie, Bruxelles : de Boeck, 2003.
CONEIN Bernard, ÂŦ Lâaction avec les objets. Un autre visage de lâaction situÃĐe ? Âŧ, Raisons Pratiques 8, 1997, Cognition et information en sociÃĐtÃĐ,  25-46.
DELMAS  CÃĐline, " ÂŦ 100 fenÊtres sur Internet Âŧ : ReprÃĐsentations et usages d'Internet par le grand public  - Communication interpersonnelle au sein d'un rÃĐseau urbain ". RHRT - Actes 2003 - Ateliers.
GARFINKEL Harold (ed.), Ethnomethodological Studies of Work, Taylor &Francis Ltd., 1986
GOFFMAN Erving, Les cadres de lâexpÃĐrience, Paris : Editions de Minuit, 1974/1991.
HEATH Chrsitian  & LUFF Paul,  Technology in Action, Cambridge University Press, 2000
LAVE J., WENGER, E., Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge: Cambridge University Press, 1991
NORMAN A. Donald, ÂŦ Les artefacts cognitifs Âŧ, Raisons Pratiques 4, Les objets dans lâaction, 1993, 15-34.
Annexes
Le moment oÃđ un ÃĐnoncÃĐ en cours en rencontre un autre est signalÃĐ par un crochet simple à gauche : [ La fin du chevauchement est signalÃĐe par un crochet simple à droite : ]
Quand il n'existe aucun intervalle entre les ÃĐnoncÃĐs adjacents, le second est produit immÃĐdiatement aprÃĻs le premier (sans chevauchement). Ils sont liÃĐs par des signes d'ÃĐgalitÃĐ (continuitÃĐ)Â : =
Les signes d'ÃĐgalitÃĐ sont aussi utilisÃĐs pour lier diffÃĐrentes parties d'un ÃĐnoncÃĐ produit par un mÊme locuteur.
Quand les intervalles surviennent lors d'un flot de conversation, ils sont notÃĐs de la maniÃĻre suivante selon la longueur de la pause: intervalle bref (.), intervalle plus long (--).
Deux points signalent une extension du son ou de la syllabe qui prÃĐcÃĻde : "qui :::"
Les autres signes de ponctuation sont utilisÃĐs comme suit :
.  Un point indique une intonation descendante, pas nÃĐcessairement la fin d'une phrase.
,  Une virgule indique une intonation continue, pas nÃĐcessairement les propositions de phrase.
?  Un point d'interrogation indique une inflexion croissante et pas nÃĐcessairement une question.
!  Un point d'exclamation indique un ton animÃĐ et pas nÃĐcessairement une exclamation.
L'emphase est signalÃĐe par le soulignement : "le mien "
Les lettres en majuscules indiquent ce qui est dit avec un volume plus haut que la conversation en cours.
Le signe de degrÃĐ est utilisÃĐ pour indiquer un passage de la conversation plus calme que le reste de la conversation en cours : °Um: :°'
Une partie de l'ÃĐnoncÃĐ est prononcÃĐe à un rythme plus rapide que la conversation en cours, est indiquÃĐe par des pointes: >  les manifestes <
Les ÃĐlÃĐments contenus entre parenthÃĻses simples relÃĻvent de l'incertitude comme : ('pose que je ne suis) ou de l'impossibilitÃĐ Ã distinguer le segment : (inaudible)
A lire aussi sur le mÊme sujet
-
CommunautÃĐ en ligne dâapprentissage et de pratique ( Cl@P ): une mÃĐthodologie pour la collaboration à distance. Par Nicolas Michinov.
-
De la logique technologique à la logique culturelle : questionner les ÃĐtudes dâusages des TICEs. Par Claire BÃĐlisle, Dominique Liautard et Eliana Rosado.
-
Des usages attendus aux usages effectifs dans lâENT de lâUNR-Languedoc Roussillon. Par Chantal Charnet.
-
De l'usage des environnements numÃĐriques de travail dans des ÃĐcoles professionnelles en systÃĻme dual de formation. Par Jean-François Perret et Isabelle Probst.
n° 5-6
Outils :
-
Chantal Charnet
MaÃŪtre de confÃĐrence HDR, UniversitÃĐ Paul ValÃĐry, Montpellier 3, CNRS FRE 2425.
CoordonnÃĐes :
UniversitÃĐ de Poitiers
15, rue de l'HÃītel Dieu - 86034 POITIERS Cedex - FRANCE
TÃĐl.: (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50
http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt - rhrt@univ-poitiers.fr